Par Gwen Duguy, libraire à l'Espace culturel E. Leclerc Porte de Gouesnou

Gwen : "Bonjour Mariapia Veladiano. Nous avons découvert récemment en France votre premier roman, La Vie à côté. Vous y racontez la vie d’une petite fille d’une laideur répulsive, au sein d’une famille gardant un secret. Comment est née cette idée de roman ?"
Maria Veladiano : "Je crois que les idées surgissent quand on est à l’écoute du monde. Elles arrivent sous la forme d’émotion, de vie, et qui écrit essaie de leur donner la parole parce qu’on peut les raconter. Travailler dans une école est un grand privilège. Le monde entier est représenté à l’école, pendant tant d’heures dans une journée nous sommes exposés, presque transpercés par les émotions fortes qui nous entourent. Et la plus terrifiante aujourd’hui est la peur de ne pas être accepté à cause de son apparence physique. Il a toujours existé un canon de beauté, mais jamais aussi strict. Aujourd’hui le canon de beauté définit la taille, la coupe de cheveux, le poids, surtout le poids, et aussi la richesse, car si on n’a pas les bons accessoires, on se sent exclus. C’est un canon strict, pervers car on le trouve partout, sur internet, dans les journaux, à la télévision, dans les films, et mensonger en plus car les lesdits mannequins sont des constructions, photographiées à peine sorties du coiffeur, de l’esthéticienne, du maquilleur, du styliste et s’il reste quelque chose encore à changer, il y a toujours Photoshop. Avec le temps, les enfants arrivent à l’école toujours plus beaux et soignés, mais cela ne leur donne pas pour autant davantage la certitude d’être acceptés. Si le canon de la beauté est strict, peu de personnes peuvent se conformer à ce canon. Presque tous s’en trouvent exclus, malheureux car ils désirent quelque chose qu’ils ne peuvent avoir car cette chose n’existe pas. Il y a une profonde tristesse dans tout cela. C’est la disparition de la force la plus puissante que les enfants ont : le désir de se faire respecter pour ce qu’ils sont et non pas pour ce dont ils ont l’air. Et ce n’est pas de leur faute. Il faut les aider à substituer la dévotion au physique par l’amour de la vie".
Gwen : Ce roman peut être lu comme une métaphore, celle d’une société de surface habitée par la peur, et donc extrêmement laide, mais gardant, comme la vie peut souvent le suggérer, une beauté, voire un don intérieur. Votre projet tenait-il du conte moderne ?
Marie V. : Il n’y a pas d’intention morale dans l’histoire de Rebecca. Le livre a été prescrit par beaucoup d’écoles en Italie. Après une rencontre, les enfants me demandent souvent : « Mais vous avez voulu écrire ce roman pour nous enseigner à ne plus se rendre, à lutter contre tout et tous s’il le faut ? » Et je réponds toujours que non et non. Une histoire arrive, on la raconte si on trouve le ton juste pour ne pas la trahir, pour l’aider à résister et la qualité morale du livre réside dans l’écriture, dans la tenue de la narration et dans la voix des personnages qui deviennent un peu notre voix. Rebecca parvient à se sauver, de manière étrange et imprévisible, mais elle se sauve, non pas parce qu’elle est une super héroïne qui lutte seule contre tous, mais pour deux raisons différentes : parce qu’elle trouve la beauté en elle à travers la musique, qui devient sa passion et sa force, et aussi parce qu’elle trouve autour d’elle des gens qui finissent par la voir. Il y a quelque chose d’effrayant dans le mythe moderne d’une personne sur mille qui réussit, l’idée que nous sommes seuls, c’est une idée dévastatrice, qui marche grâce à une modernité aveugle qui ne voit pas les morts qu’elle laisse de côté sur son chemin, une égoïste, qui pense qu’elle peut être heureuse et le jeter à la face du monde malheureux. Mais quelle idée ! Rebecca réussit parce qu’elle n’est pas seule. S’il y a une morale, elle se situe dans l’histoire elle-même et dans le fait que nous pouvons tous être des compagnons et compagnes des Rebeccas qui nous entourent, hommes ou femmes évidemment. On naît et renaît dans les relations.
Gwen : Vous avez pris le parti de ne pas imposer au lecteur la souffrance intérieure de Rebecca. Cette petite fille évolue, et le lecteur peut se demander si elle souffre de son extrême laideur, si elle ne la vit pas à coté, justement. Pourquoi ?
Maria V. : Rebecca s’exprime avec une voix qui a trouvé les mots pour raconter sa propre vie, à travers le regard d’une enfant et puis plus tard d’une jeune fille, mais aussi pour raconter le monde qui l’entoure. Dans la narration j’ai voulu montrer, sans le dire d’un point de vue moral, que c’est le monde qui entoure Rebecca qui est laid, pas elle. Ou mieux encore, que la vraie laideur, la vraie horreur réside dans le jugement, provient toujours d’un préjugé qui stoppe net l’autre au seuil d’une vie qu’il ne peut pas vivre. Souvent le préjugé est le résultat de la peur, bien sûr, et cela pourrait absoudre le monde adulte si, justement, l’adulte n’était pas celui qui doit garantir, assurer une bonne vie pour tout le monde. La plus grande faute est de faire semblant de ne pas voir ce que l’on comprend. Rebecca rencontre l’école à un certain point. Il y a une « bonne » école, qui est l’école primaire, avec la maîtresse Albertina qui l’appelle par son nom, pour la première fois, et lui assure une place, le droit d’exister. Et rien n’arrive de mal à Rebecca. Et puis après il y a la « mauvaise » école, dans laquelle les professeurs ne font activement rien qui puisse être sanctionné. Mais ils font la pire chose, c’est-à-dire qu’ils font semblant de ne pas voir ce qui se passe sous leurs yeux. Ce qui se passe c’est que Rebecca est marginalisée, considérée de trop, une intrus à expulser. Et alors tout peut arriver ? Et de fait tout arrive. L’omission est notre mal.
Gwen : Un autre grand roman, sur un sujet similaire, fut écrit en France par François Mauriac en 1922 : Le baiser au lépreux. Mauriac était un écrivain chrétien, et dans votre biographie, il est indiqué que vous avez suivi des études de théologie. Avez-vous lu le roman de Mauriac ? Et quelle importance votre formation théologique occupe dans ce roman ?
Maria V. : Je n’ai pas lu le roman de Mauriac, je le regrette. La vie à côté n’est pas un roman religieux, on n’y parle pas de Dieu, on raconte comment une société qui se pense implicitement bonne et juste s’avère en réalité profondément fausse et perverse. Le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer parlait de « grands masques du mal », c’est-à-dire de comment le mal se travestit en bien et nous éblouit. Nous appelons normalité le fait que la vie désormais appartienne à peu de personnes et que les exclus soient en perpétuelle augmentation. « Le monde est ainsi fait, nous n’y pouvons rien », est la phrase la plus épouvantable que nous pouvons nous raconter et transmettre à nos enfants. Pour toutes ces raisons, nous n’avons qu’une seule vie et il est impensable d’accepter l’exclusion comme un fait historique. C’est cela que je dénonce dans mon roman, il y a la volonté de vivre que Rebecca ressent intensément, l’horreur de l’hypocrisie, le désir de justice. La foi dans la vie et dans l’Homme. Mais ce n’est pas un roman religieux dans le sens que l’on donne communément à ce mot. Mais c’est un roman sur la foi en la vie, c’est certain.
Gwen : Plusieurs bonnes personnes entourent Rebecca : la servante, une amie de classe, la tante de Rebecca : a-t-on tous, dans la vie, quelques belles âmes tutrices et protectrices ?
Maria V. : Je pense que la vie peut se réparer. Aujourd’hui on ne croit plus beaucoup à l’art de réparer. Le mythe du succès à n’importe quel prix fait penser de manière manichéenne : les choses vont bien ou mal, ou on est très riche ou très pauvre, beau ou laid, quelqu’un ou personne. Alors que ce n’est pas si simple. Les histoires peuvent mal commencer, mais nous pouvons tout réparer. Il suffit d’avoir la chance de trouver des figures réparatrices et d’être nous-mêmes des réparateurs de la vie, pour les autres. Rebecca rencontre la tante Maddalena, pour qui la vie n’a pas été facile, mais qui a trouvé dans l’acte de réparer la vie de Rebecca une manière de réparer la sienne. Puis elle trouve la dame de la nuit, la signora De Lellis, qui est une figure de « sainteté laïque quotidienne ». Ce sont des gens qui savent ériger une barrière contre le mal. Il faut comprendre qu’ils l’ont reçu, qu’ils ont été eux-mêmes frappés par le mal, et pour cette raison ils savent le reconnaître et dire : « Le mal ne passera pas par ici ». Il ne s’agit pas de saints de calendriers, ils ne font pas des choses extraordinaires, ils ne croient pas forcément en Dieu, simplement ils font ce qui doit être fait. Imaginez comme le monde serait différent si on suivait simplement notre nature de personnes responsables les uns vis-à-vis des autres.
Gwen : Nous pouvons lire votre roman comme un conflit entre l’apparence et la profondeur : l’amour, semblez-vous dire, se découvre dans une plongée profonde, comme Rebecca qui place toute sa vie dans son talent de pianiste et y découvre le don de la musique, et donc le don de l’amour. Faut-il souffrir pour vivre ces révélations ?
Maria V. : Non. Il n’y a aucune garantie que la souffrance mène à une découverte fondamentale et positive dans la vie. Parfois la souffrance humilie tellement qu’il ne reste plus d’énergie pour grand-chose. La souffrance n’est plus infligée, plus souhaitable, elle est combattue. Mais il est vrai qu’une passion aide à sortir de soi-même et permet d’oublier sa propre douleur. La musique fournit une voix à Rebecca. Dans la maison du silence Rebecca trouve sa propre voix, celle de la musique qui traverse les pièces, sort par la fenêtre, prend le large jusqu’au fleuve et peut-être, elle n’en est pas sûre, mais peut-être qu’elle arrive même jusqu’à sa mère.
Gwen : Une grande importance est donnée, au sein de cette famille bourgeoise dont vous nous contez l’histoire, au secret, et au mensonge. La bourgeoisie, qui est à l’image de la société, est-elle bâtie sur le mensonge ?
Maria V. : Il y a beaucoup de mensonges dans notre société. Il y a une défense de notre petit monde parfait et normal, pensant que la vie y réside toute entière. Et quand la pauvreté et l’injustice s’approchent petit à petit on devient toujours plus faux pour se défendre. Je pense que nous vivons dans un monde très malheureux, et donc à cause de cela plus mauvais. Mais il faut toujours résister et agir à notre petite échelle, penser comment mettre une barrière au mal. Tout le monde veut être riche ? Nous, nous ne le sommes pas. Tout le monde est arrogant et l’arrogance semble devenir naturelle ? Je ne le suis pas et nous ne le sommes pas. A l’école, au travail, dans les minutes et les jours que nous n’avons pas encore vécus, nous ne le sommes pas. Le récit peut donner une voix aux injustices que nous vivons et cela est déjà un réparateur et une barrière contre le mal.
Gwen : Votre écriture est ciselée, chaque mot fait sens, et chaque choix de nom et de prénom a une portée intérieure très forte, comme le choix d’appeler votre héroïne Rebecca. Avez-vous composé votre roman par rapport à une quête et à une construction sémantique ?
Maria V. : Merci pour cette question. Les récits sont faits d’histoire et de rêve. Chaque histoire a son ton que l’on cherche et cherche encore jusqu’à ce que chaque mot ait trouvé sa place. J’ai écrit cette histoire une dizaine de fois, parce que tel ou tel mot sonnait faux. Je ne sais pas si j’ai réussi, mais dans ce récit j’ai essayé de trouver le son d’une harmonie qui maintient toute entière la tempête d’une vie reniée. J’aime les mots, je crois en leur pouvoir salvateur, dans la mesure où les mots permettent de se comprendre en profondeur, tracent la route du vivre ensemble. On assiste à un acte de destruction dans le langage. Surtout nous, en Italie où le langage violent de la politique a aidé à l’affirmation d’un langage double, d’opposition dur et aveugle, Beau-Laid, Je veux-Je ne veux pas, italien-étranger, ami-ennemi. C’est un langage qui prépare la guerre. La langue est notre richesse, les paroles portent tant de mondes à connaître et à raconter. Dans la nuance réside la possibilité de désamorcer les malentendus. Quant aux noms, nos noms nous dessinent. Parce qu’ils proviennent toujours d’une histoire. La grande et connue Magari, le nom d’un personnage dont nous savons tout. On pense au nom explosif de Francesco porté par le pape. Mais on y pense aussi quand il est porté par des enfants qui s’appellent ainsi. Ou bien au fait de s’appeler Giovanna, Carlo, Luigi en France. Les noms portent l’histoire, parfois l’histoire familiale d’une tante étrange, d’un grand-père dont on veut se rappeler. Les personnages de mes romans ont toujours des noms « parlants ». Rebecca signifie « celle qui plaît » et pourtant elle est laide. C’est un nom qui porte la douleur à l’intérieur, rappelle le désir de la mère, désir d’une fille belle qui puisse réparer l’histoire de douleurs et de culpabilités de laquelle elle est issue. Elle enferme à jamais dans son nom un secret de famille monstrueux. La dame de la nuit s’appelle Gabriella, comme l’archange, et son nom est De Lellis, comme Camillo De Lellis, fondateur des « camilliani », dédiés au soin des malades. La dame de la nuit accueille Rebecca et lui offre peu à peu la vérité et c’est ainsi qu’elle la guérit et la sauve. Du mieux qu’elle peut.
Gwen : Dans votre roman, le langage de la laideur suscite le langage de la beauté, comme une confrontation des opposés qui conduit à une union des contraires. Cette dimension philosophique, voire ontologique, est-elle pour vous une tentative d’interprétation du Verbe ?
Maria V. : Pour celui qui croit que Dieu est présent dans les paroles sacrées de l’écriture. C’est un Dieu qui est consigné en paroles, un Dieu qui se fie en l’homme, complètement. Parce que la parole peut être prise et lue, prise et abandonnée, peut être laissée là pour toujours, ou manipulée et utilisée comme une clé doctrinale sur la tête de son prochain. Mais dans la parole, dans toutes les paroles du monde, réside notre vie conservée ou trahie. Pour cette raison, elles sont choisies avec attention et aimées. Raconter le beau et l’horreur du monde permet de se promener les yeux ouverts, voyant la laideur, et de découvrir la vie que l’on veut mener. On pense au pouvoir presque divin de certains mots : je le fais, je t’aide, nous sommes, on essaie ensemble, tu vois comme c’était facile ? Ne t’en fais pas, nous y sommes !
Gwen : Ultime question : avez-vous d’autres projets ? D’autres romans, publiés en Italie, que nous devrions attendre en France ?
Maria V. : J’ai publié cette année en Italie un roman dont le titre est Le temps est un dieu bref. C’est l’histoire d’une femme appelée Ildegarda qui se dit croyante car elle a « connu Dieu, la présence et l’absence », et qui s’interroge sur la douleur du monde du point de vue non pas d’une foi qui protège et juge, mais du point de vue de notre humanité commune. La France a une belle tradition de romans qui explorent le thème de la douleur. Je serais ravie de porter Ildegarda à Paris !
Merci Mariapia Veladiano.
Merci à vous. Et bonne lecture à tous !
Propos recueillis par Gwen, libraire à l'Espace culturel E.Leclerc Porte de Gouesnou
Traduction de l’italien : Claire Do Sêrro
Mariapia Veladiano
La Cosmopolite / Stock
Parution : août 2013
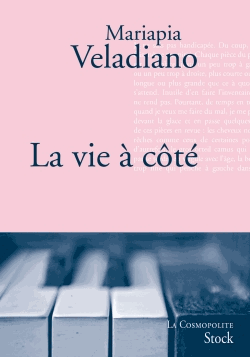

Écrire commentaire